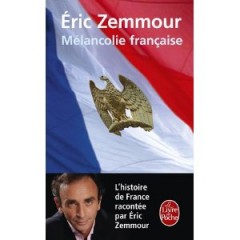De l’érotisme, qualité proprement humaine qui fait emprunter au désir sexuel le canal de l’inventivité mutuelle, il n’existe pas de définition véritablement satisfaisante. L’érotisme n’est pas le contraire de la pudeur, qui n’a de sens que pour autant qu’elle rend désirable. Il n’est pas non plus le contraire de la pornographie, qui ne redevient elle-même suggestive (c’est son grand avantage) que lorsque, montrant absolument tout, elle révèle du même coup qu’il n’y a rien à voir. Du reste, D.H. Lawrence avait déjà tout dit quand il dénonçait l’hypocrisie d’une société qui condamne la pornographie tout en restant aveugle sur sa propre obscénité. N’importe quel discours publicitaire, n’important quel discours relevant de la logique du marché, aujourd’hui, est assurément plus obscène qu’un vagin ouvert photographié en gros plan.
Pendant des siècles, l’érotisme a été dénoncé comme contraire aux « bonnes mœurs » parce qu’en excitant les passions sensuelles, il contredisait une morale fondée sur la dévalorisation de la chair. Contrairement à d’autres religions, le christianisme a toujours été incapable de produire une théorie de l’érotisme, non qu’il ait jamais ignoré le sexe, mais au contraire parce qu’il en a fait une obsession négative. Passé le temps des martyrs, l’abstinence devint la marque de la vie dévote et la sexualité le domaine d’élection du péché. L’activité sexuelle, regardée comme un pis-aller, n’était plus admise que dans le cadre conjugal. L’Eglise condamnait une sexualité déconnectée de la seule visée procréative, tout en cultivant l’idéal virginal d’une procréation sans sexualité. Raison pour laquelle, sans doute, le discours sur le sexe est si longtemps resté purement littéraire, médical ou simplement vulgaire – bien qu’il soit révélateur que, de tout temps, le nu ait servi de base à l’enseignement des beaux-arts, comme étant le plus approprié à former à la catégorie du beau.
La modernité naissante a ensuite entrepris un vaste travail de désymbolisation, dont l’érotisme a été la victime. Se fondant sur une idée de l’être humain comme individu autosuffisant, elle s’interdisait déjà par là de penser une différence sexuelle qui, par définition, implique l’incomplétude et la complémentarité. La péjoration des passions et des émotions, supposées génératrices de « préjugés », a d’autre part accompagné la montée en puissance de l’individu au profit du rationalisme scientiste. L’intelligence sensible – celle du corps – s’est alors trouvée dévaluée, soit comme porteuse de pulsions « archaïques », soit comme émanant d’une « nature » dont l’homme, pour devenir proprement humain, était appelé à s’émanciper. La modernité, enfin, a systématiquement reconverti l’intérêt en besoin, et le besoin en désir. Sans voir que le désir ne se ramène précisément pas à l’intérêt.
Auteur d’une belle Anthologie historique des lectures érotiques, Jean-Jacques Pauvert estime qu’« en l’an 2000, malgré les apparences, il n’y a plus guère – ou plus du tout – d’érotisme. Cette parole d’expert peut surprendre. Elle ne fait en réalité que constater que l’érotisme, hier bridé par une censure qui le vouait à la clandestinité et à l’interdit, est aujourd’hui très exactement menacé par son contraire.
De même que la surabondance d’images empêche de voir, et que la grande ville est en fait un désert, le sexe assourdissant devient inaudible. L’omniprésence des représentations sexuelles enlève à la sexualité toute sa charge. Contrairement à ce que s’imaginent les réactionnaires pornophobes, héritiers du nouvel ordre mondial reagano-papiste, elle tue l’érotisme par excès, au lieu de le menacer par défaut. C’est là encore un effet de la modernité. Le procès moderne d’individualisation a en effet abouti, d’abord à la constitution de l’intimité, puis au renversement dialectique de l’intimité dans l’exhibition de soi au nom d’un idéal de transparence. Ce passage de l’intimité à l’exhibitionnisme (pris comme « témoignage », et donc critère de vérité) est parfaitement illustré par l’émission de « télé-réalité » Loft Story, image fidèle, concentré spéculaire (et crépusculaire) de la société actuelle, qui ne force le trait que pour mieux en faire apparaître les lignes de force : voyeurisme pauvre et niaiserie consensuelle, huis clos programmé par la loi de l’argent, exclusion interactive sur fond d’insignifiance absolue. Que les foules soient fascinées par ce miroir qu’on leur tend n’a rien pour surprendre : elles y voient en petit ce qu’elles vivent tous les jours en grand.
Le sexe est aujourd’hui convié à se mettre au diapason de l’esprit du temps : humanitaire, hygiéniste et technicien. La normalisation sexuelle trouve des formes nouvelles, qui ne cherchent plus à réprimer le sexe mais à en faire une marchandise comme les autres. La séduction, trop compliquée, devient une perte de temps. La consommation sexuelle doit être pratique, performante et immédiate. Objet machinal, corps-machine, mécanique sexuelle : la sexualité n’est plus qu’un affaire de recettes « techniques » au service d’une pulsion scopique de la quantité. Dans le monde de la communication, le sexe doit cesser d’être ce qu’il a toujours été : semblance de communication d’autant plus délectable qu’elle s’inscrit sur fond d’incommunicabilité. Dans un monde allergique aux différences, qui à bien des égards a reconstruit socialement et culturellement le rapport des sexes sous l’horizon d’un dimorphisme sexuel atténué, et qui s’entête à voir dans les femmes des « hommes comme les autres », alors qu’elles sont en réalité l’autre de l’homme, il faut qu’il n’« aliène » plus, alors qu’il est un jeu d’aliénations volontaires. Le désir politiquement correct de supprimer le rapport de forces qui s’établit tantôt au bénéfice de l’un des sexes et tantôt de l’autre, dans une conversion mutuelle, tue ainsi l’érotisme, car il n’y a pas de rapport amoureux qui se déploie dans une plate égalité, mais seulement dans une joute, une instable inégalité qui permet le retournement de toutes les situations. Le sexe n’est que discrimination et passion, attirance ou rejet également excessifs, également arbitraires, également injustes. En ce sens, il n’est pas exagéré de dire que le véritable érotisme – sauvage ou raffiné, barbare ou ludique – reste plus que jamais un tabou.
La volonté de supprimer la transgression tue pareillement l’érotisme. Car il y a bien des normes en matière sexuelle, comme il y en a en toutes choses. L’erreur est de croire que ce sont des normes morales, l’autre erreur étant de s’imaginer que n’importe quelle conduite peut être érigée en norme, ou que l’existence d’une norme délégitime du même coup ce qui est hors-normes. L’érotisme implique la transgression, pour autant que cette transgression reste possible sans cesser d’être transgression, c’est-à-dire sans être posée comme norme.
Entre les « jeunes des cités » pour qui les femmes ne sont que des trous avec de la viande autour, les suceuses professionnelles aux formes siliconées et les magazines féminins transformés en manuels de sexologie pubo-coccygienne, l’érotisme apparaît ainsi verrouillé de toutes parts. Les jeunes, en particulier, doivent faire face à une société qui est à la fois beaucoup plus permissive et beaucoup moins tolérante que par le passé. De même que la domination débouche en général sur la dépossession, la prétendue libération sexuelle n’a finalement abouti qu’à de nouvelles formes d’aliénation. Mais le sexe, parce qu’il est avant tout le domaine de l’incertitude et du trouble, se dérobe toujours à la transparence. L’exhibitionnisme le rend plus opaque encore que la censure, car à ce désir de transparence il répond toujours par la métaphore. A la mise en lumière sous les projecteur, le monde du sexe oppose, heureusement, ce qu’André Breton appelait son « infracassable noyau de nuit ».
Robert de Herte (Eléments 102, septembre 2001)